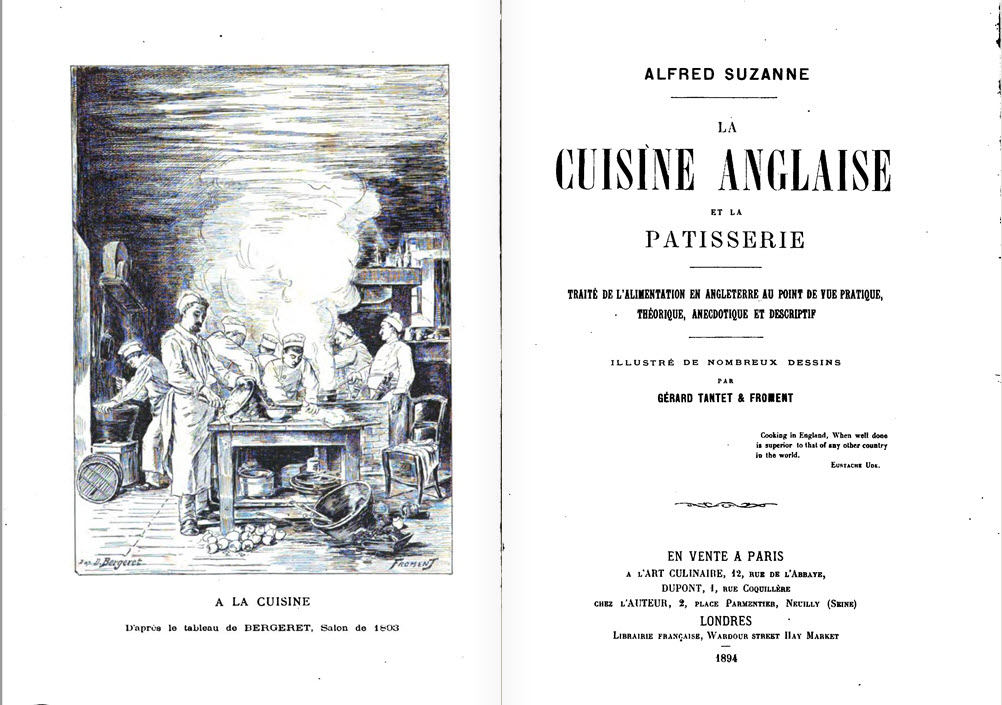
Comme tout français amateur de rugby qui se respecte, je cultive une légère anglophobie. Oh pas bien méchante, parce que dans ce sport, les antagonismes finissent toujours autour d’un verre et parce que, en tant qu’aubergiste, je connais, et j’apprécie, ce peuple de grands voyageurs. Anglophobie suffisante toutefois, pour m’être délecté à la lecture de l’ouvrage chiné chez un bouquiniste il y a quelques années. J’ai retrouvé récemment dans ma bibliothèque : « La cuisine anglaise et la pâtisserie », sous-titré : « traité de l’alimentation en Angleterre au point de vue pratique, théorique, anecdotique et descriptif ». L’auteur, Alfred Suzanne, le publia en 1894, et en a commis quelques autres ; de plus il collabora à diverses revues culinaires. Alfred Suzanne était un cuisinier français qui œuvra quarante ans outre Manche. Cet ouvrage est un petit bijoux étonnant grâce a une plume alerte, présentant une étude très poussée des comportements alimentaires de la population anglaise dans sa diversité, et enfin par la richesse des considérations anthropologiques ou sociologiques à chaque page et dans la moindre recette ou presque.
Au dix-neuvième siècle finissant, l’entente cordiale est de mise, et la mode prône l’anglomanie. Les sports anglais font fureur en France, tout autant que le lunch, le five o’clock tea et la façon de s’habiller. Alfred Suzanne s’en réjouit et nous le dit dès les premières lignes de sa préface : il aime l’Angleterre. N’en déplaise à certains gastronomes chauvins, ajoute-t-il, il y a dans la cuisine anglaise nombre d’excellents mets qui ne sont pas à dédaigner. « Fiers de notre supériorité culinaire, incontestable du reste, nous avons de tout temps, dominés par d’absurdes préjugés, trop négligé les mets d’origines étrangères ». Ce n’est pas pour succomber à cette mode que l’auteur se met à l’ouvrage, mais pour participer à la formation de ses collègues cuisiniers français débarquant du ferry à Douvres. Il nous apprend que plus de 5000 de nos compatriotes étaient disséminés dans les cuisines de l’aristocratie, des clubs ou des restaurants et palaces de la seule région de Londres. Passionnantes sont ses descriptions des usages et de l’organisation en vigueur parmi la domesticité des maisons bourgeoises. Les chefs français, très bien payés, en étaient les seigneurs et il nous conte la réussite de nombre d’entre eux, tels l’inventeur de génie Alexis Soyer ou Auguste Escoffier.
Il fallait donc, dit-il, que ce traité soit écrit. Il explique plus loin : il arrive constamment qu’un cuisinier nouvellement débarqué en Angleterre soit obligé d’abandonner sa position après un court séjour parce qu’il ignore les plus simples notions de la cuisine britannique ! Il cite en exemple ce chef qui avait attaché à un cerisier dans le jardin de l’amiral qui l’employait, une carapace de tortue. Il voulait en faire un épouvantail alors que c’est la meilleure partie de la bête !
« Le gentilhomme anglais a toujours un penchant prononcé, qu’il dissimule mal, pour sa cuisine nationale ; aussi se fait il une règle d’y revenir à certains intervalles, non seulement par goût, mais aussi par raison ; car son estomac robuste, habitué dés l’enfance à une nourriture substantielle, s’accommoderait mal d’un régime essentiellement français avec nos potages légers et nos mets délicats » C’est là tout le style involontairement désopilant, pour un lecteur du vingt et unième siècle, du livre d’Alfred Suzanne. Il montre tout au long qu’il a aimé ce pays, il en vante les produits souvent supérieurs aux nôtres, – comme le bœuf ou le mouton, mais dix lignes plus loin, il affirme que la femme française la plus misérable n’a pas besoin d’apprendre la cuisine, car c’est inné chez elle. Quant à la ménagère anglaise, ses connaissances se bornent à savoir cuire des pommes de terre et à bouillir le dimanche un morceau de viande que son mari trouvera froid sur sa table toute la semaine. Il se comporte comme un missionnaire de la gastronomie, mais au-delà, le travail d’inventaire sur plus de 300 pages de recettes parfaitement décrites en fait un observateur méticuleux des mœurs culinaires de nos voisins.
Il est quelques plats, certes un peu allégés (comme l’a été la cuisine française depuis cette époque), qui ne dépareraient pas nos meilleures tables. Notamment les soupes et les poissons, comme ces huîtres, enrobées d’une fine tranche de lard et grillés, avant d’être posées sur un toast avec un peu de chapelure. D’autres, la majorité, laissent sceptiques comme ce « Beefsteak and Oyster pudding » : dont voici la recette.
Préparer en escalopes minces deux livres de filet de bœuf. Faire une pâte à la graisse de bœuf. A cet effet, hacher très fin trois cent cinquante grammes de graisse de bœuf que l’on amalgame avec une livre de farine, une forte pincée de sel, et de l’eau en quantité suffisante pour former une pâte ferme, avec laquelle on fonce un bol de cuisine préalablement beurré. Assaisonner les escalopes de sel, poivre, oignon haché, champignons et persil, puis les ranger dans le moule. Ajouter trois douzaines de grosses huîtres blanchies et ébarbées puis un peu de bouillon et recouvrir d’une abaisse de pâte. Envelopper ensuite le tout dans une serviette beurrée, dont on attache solidement les extrémités avec une ficelle. Le pudding est alors plongé à l’eau bouillante et doit cuire pendant deux heures et demie. On égoutte ensuite quelques minutes, on enlève la serviette, et on renverse le pudding sur un plat. C’est prêt ! Il parait que les Anglais en raffolent ; je voudrais goûter, mais j’hésite à confronter ces beaux produits à ce traitement.
A la lecture de quelques passages de ce livre, je me suis rappelé que le Royaume-Uni a interdit le gavage des canards, au nom du droit des animaux. Je comprends qu’ils aient beaucoup à se faire pardonner. Le sentimentalisme envers les animaux étant une de nos contemporanéités, Alfred Suzanne, que cela ne semble pas choquer décrit quelques pratiques qui font frémir : les tortues des mers du sud, dont les anglais étaient friands, clouées vivantes avec d’énormes clous aux quatre pattes en fond de cale, voyageant par milliers et durant plusieurs semaines… Que penser également d’une façon bien barbare de ciseler le saumon à la sortie de la rivière, ou encore d’occire le cochon de lait en le fouettant avec des verges ?
Beaucoup plus distrayante est l’espèce ‘d’anthropologie physique’ présente tout au long du texte. On voit la distance entre les idées d’un honnête homme du 19e et les nôtres. Alfred Suzanne ne trouverait heureusement plus d’éditeurs pour de telles sottises xénophobes alors qu’il ne cesse de proclamer son affection pour les britanniques. Je ne résiste pas à retranscrire ce paragraphe comparatif des qualités des garçons de restaurants de différentes nationalités :
« La célérité dans le service est une chose qui laisse beaucoup à désirer dans les restaurants de Londres, et il en sera ainsi tant que ce service sera fait par des garçons anglais, auxquels il manque le « je ne sais quoi », qui est le propre du garçon de salle français. Un chef d’établissement ne saurait se montrer trop difficile dans le choix des gens de service préposés à la salle à manger. L’allure, la prévenance, le tact et même le physique du garçon ont une grande influence sur l’esprit du client, qui trouvera souvent son dîner mauvais, parce qu’il aura été servi par un homme dont la compétence n’est pas à hauteur de sa fonction. On trouve dans les restaurants et les hôtels, des garçons de toutes nationalités. L’Allemand est recherché parce qu’il est polyglotte, mais à part cet avantage, il a le défaut d’être brusque et souvent impoli. L’Italien est très obséquieux, trop bavard et trop flâneur. Le Français seul réunit les qualités désirables, il est actif, empressé, obligeant, propre et poli. Quant à l’Anglais, il n’a pas le génie de l’emploi. C’est un type à part ; il est d’une politesse excessive, mais d’un aspect flegmatique, raide et guindé, et d’une lenteur sans pareille. Pour rien au monde on ne lui ferait changer son allure, et quelles que soient les épithètes dont on le gratifie, sa figure conserve la même sérénité, le même calme, le même contentement ; comme costume il porte la cravate blanche, l’habit à queue de morue graisseux et râpé, et un pantalon de drap noir dont on aperçoit la trame. Il se distingue surtout par la structure de ses pieds. A force de monter et de descendre l’escalier, les ligaments du talon se sont relâchés, la courbure en a disparu, et la plante du pied est complètement devenue plate : c’est ce qu’il fait qu’il marche en se dandinant à la façon des palmipèdes. Pourtant, pour rendre justice au Waiter, on doit reconnaître qu’il est incontestablement supérieur à ses collègues étrangers, lorsqu’il fait son service dans les grill-rooms, les bars et les shop-houses de la Cité. Là, il est dans son élément. Il porte le même costume que les maîtres d’hôtel du West End, seulement la cravate et le plastron sont d’un blanc douteux, et l’habit et le pantalon plus graisseux et plus râpés. … »
Sorry, good game !
